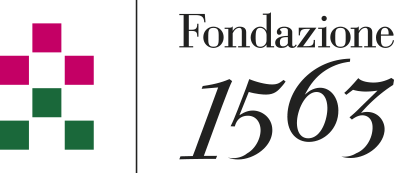6 grands blocs de granit «noir Afrique» disposés horizontalement sur le sol, qui portent sur la partie supérieure la phrase gravée «dove le stelle si avvicinano di una spanna in più» (2001-2013), sur laquelle on peut monter et qui permet aux étoiles qui se succèdent à sa verticale nuit et jour de se rapprocher «encore d’un empan».
Toujours dans le parc supérieur on trouve les grandes Allées, les bosquets où l’on peut apercevoir les paons et les vanneaux huppés, et le Fantacasino, l'attraction du Bosquet des jeux conçue pour les familles et un public de tous les âges, qui propose dans un esprit moderne l’utilisation des jardins dans leur fonction de lieu de loisirs.
L’Allée de terrasse
Cette allée, parallèle à l’Allée centrale, située en haut d’une terrasse, existait déjà, soutenue par un mur, dans les jardins dessinés par Amedeo de Castellamonte dans la seconde moitié du XVIIe siècle.
Elle prit une nouvelle importance quand se concrétisa le prolongement extérieur de l’axe longitudinal de la Grande Galerie sur un projet de Michelangelo Garove au début du XVIIIe siècle, achevé par la suite par Filippo Juvarra. Dans la première moitié du XVIIIe, les années de la grande transformation dei jardins, l’Allée de terrasse, désormais sans mur ni balustrade, au-dessus d’une pente herbeuse, marquait uniquement avec la verdure, à l’ombre des ormes, la limite nord du parc supérieur. L’Allée centrale, parallèle, soulignait sa progression apparemment infinie, que scandaient les bosquets.
Le tracé actuel, comme pour les autres parties du parc supérieur, est basé sur les plans et levés du XVIIIe siècle et sur les lignes enfouies dans le terrain, qu’ont montrées les photographies aériennes. Des tilleuls assureront l’ombre sur toute la longueur. Une haie de Rosa Gallica court sur le bord.
Le Grand Parterre
À partir de 1716, Filippo Juvarra reprend le projet de Michelangelo Garove et achève la Grande Galerie, la Grande Écurie e l’Orangerie. Dans l’aménagement des jardins l’intérêt se concentre alors sur la façade constituée par la zone attenante aux nouveaux bâtiments. On voit ainsi surgir un parterre fleuri, des plates-bandes de gazon, des ifs sculptés, des agrumes en pot et de véritables « pièces » avec des parois et des voûtes végétales le long de tout le périmètre.
Pendant tout le XVIIIe siècle c’est là l’espace de représentation à l’extérieur et le cadre de passe-temps agréables. Le centre correspond au croisement des deux axes orthogonaux, alignés respectivement sur l’arche médiale de la Grande Galerie et la porte centrale de l’Orangerie, qui continuaient dans les allées : un qui allait vers la zone où furent plantés les potagers et les pépinières, l’autre, l’Allée royale, qui traversait les bosquets et conduisait au labyrinthe.
Avant les travaux de restauration cette zone accueillait de nombreux pavillons occupés par les militaires.
L’actuelle réalisation évoque le jardin du XVIIIe siècle en mettant en relief ses étroites relations avec le palais et le ton de grandeur donné par les proportions. L’iconographie historique, avec entre autres un tableau de Carlo Randoni, et les traités français (Antoine- Joseph Dezailler d’Argenville) ont été très utiles pour l’interprétation de cet espace. Les pièces de «Verzura» qui délimitent le Grand Parterre créent des parcours pour des promenades à l’ombre entre des « murs » de végétation formés par des haies de charmes.
Les bosquets
Sur le dessin des nouveaux jardins, élaboré au XVIIIe siècle par les architectes français qui collaborèrent avec Michelangelo Garove, la zone rectangulaire du parc supérieur parallèle à l’Allée centrale, jadis destinée à la chasse pour les dames de la cour, apparaît entièrement sillonnée longitudinalement par des allées qui projetaient vers l’ouest les lignes du complexe architectural. D’autres allées les croisaient perpendiculairement en formant des carrés plantés de bosquets, à leur tour sillonnés par des parcours en diagonale (en forme de croix de saint André). Le projet prévoyait la rénovation également du parc inférieur et des abords immédiats du palais dans le parc supérieur, mais dans la réalisation la priorité a été donnée aux douze bosquets, tel qu’il résulte d’un levé de 1710, précédant de peu l’intervention de Filippo Juvarra.
Les photographies aériennes ont dévoilé sur le terrain les traces du plan du XVIIIe siècle, qui ont été reprises dans le projet actuel.
Le choix des arbres s’attache à souligner le dessin géométrique dans la dimension verticale, avec des essences qui atteignent des hauteurs différentes : les charmes à l’intérieur des bosquets, des érables, des cerisiers et des chênes rouvres sur le périmètre, des buis et des ifs sur les petites allées diagonales.
Les bosquets de la musique et des jeux, comme déjà au XVIIIe siècle, ont été destinés à des activités récréatives.
Le Jardin des Roses
Sur le dessin du XVIIIe lié au projet de Michelangelo Garove, qui confirmait et développait le jeu de géométries des plans du XVIIe, à proximité du palais, est représentée une zone rectangulaire avec une fontaine centrale et des allées en diagonale. Dans l’alignement des deux rangées de bosquets, sa superficie correspond à deux boqueteaux.
Cette partie du projet était encore à compléter lorsqu’intervint Filippo Juvarra, qui réalisa un «jardin à l’anglaise», c’est-à-dire deux carrés avec des parterres de gazon et un développement ininterrompu de pergolas. Pour chaque carré le dessin partait d’un rectangle central inscrit dans une ellipse traversée par des parcours orthogonaux et en diagonale.
Dans l’élaboration actuelle, qui a concerné la superficie correspondant à un des deux carrés de Juvarra, des berceaux de formes modernes soutiennent une variété historique de rosiers grimpants Alberich Barbier, qui ne fleurissent qu’une fois dans l’année. Une variété buissonnante de roses remontantes Marie Pavie et les rosiers grimpants sont à l’apogée de leur floraison en mai, selon les conditions climatiques de la saison.
L’Allée Royale
Sur le dessin des architectes français qui collaborèrent avec Michelangelo Garove au début du XVIIIe siècle une allée est - ouest divise en deux rangées les douze carrés des bosquets. Il s’agit de l’Allée royale qui, comme toute la zone des bosquets, était déjà réalisée en 1710, peu de temps avant l’intervention de Filippo Juvarra.
Dans les vingt premières années du XVIIIe siècle l’Allée royale acquiert l’importance que son nom reflète. En effet le «jardin à l’anglaise» et le «parterre fleuri» sont réalisés, le premier correspondant à la zone occupée aujourd’hui pour moitié par le Jardin des roses et le second par le Grand parterre.
La façade de l’Orangerie vient ainsi créer pour l’Allée une précieuse toile de fond, avec la porte centrale sur son axe. L’élégance était confiée à la rigoureuse scansion géométrique, qui plaçait un rond-point avec une fontaine tous les deux croisements que traçaient les allées orthogonales.
Quant à Juvarra, lui aussi ajouta de la valeur à ce parcours en introduisant un labyrinthe à son extrémité.
Le tracé actuel, comme pour les autres parties du parc supérieur, se base sur des dessins et levés du XVIIIe siècle et sur les lignes observées sur le terrain grâce à la lecture de photographies aériennes. Les rangées d’arbres, plantées actuellement sur une longueur limitée, sont constituées de chênes rouvres.










 Réserver
Réserver